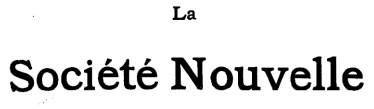René Ménard
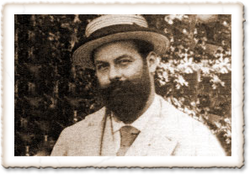
MENARD, René (1862-1930) :
René Marie Auguste Ménard est le fils du peintre René-Joseph Ménard (1827-1897) et neveu de Louis-Nicholas Ménard (1822-1901), directeur de la Gazette des beaux-arts, critique d'art, professeur et secrétaire de l'Ecole des Arts Décoratifs, dont il fit d'ailleurs un portrait très expressif présenté au Salon de 1894. Il reçoit donc une éducation artistique et intellectuelle classique. Il fut l'élève de Baudry et de Bouguereau, puis de Lehmann et à l'Académie Julian. Il débute au Salon des Artistes français en 1883 et se fit remarquer par des paysages. Il participe par la suite au SNBA, mais il aime davantage les expositions plus restreintes du genre de celle de la Société Nouvelle ou des Pastellistes.
Dès ses débuts, il manifeste un goût très vif pour l’Antiquité qui se traduit par un idéalisme symboliste un peu démodé dans des lumières chaudes, dont les figures sont d’un académisme sobre et grave. « Il passa sa jeunesse à Barbizon où il rencontra Millet et où il vit peindre Corot. »[2] Il semble vouloir redécouvrir la nature et entrer en communion avec elle. Il fait apparaître dans son œuvre un retour aux canons classiques, en affirmant un goût prononcé pour le crépuscule et l’obscurité, tout en adoptant la lumière de l’Impressionnisme.
« Oui, c’est un vrai classique, parce qu’il sait retrouver l’antique beauté dans l’éternelle nature et que le paysage historique n’est à ses yeux qu’un moyen de rendre visible la sereine majesté de ce beau panthéisme ».[3]
Il est souvent considéré comme un successeur de Poussin lorsqu’il réduit le personnage humain dans le champ de la toile au profit d’une nature envahissante. Ses nuages font l’admiration des critiques.
Assez vite, il affirme ses qualités de décorateur - qui elles, le classent parmi les suiveurs de Puvis de Chavannes - en produisant des œuvres plus importantes, empreintes de charme poétique, comme son exposition au Salon de 1899, où il présente six toiles Harmonie du Soir, Terre antique, Vue sur la mer, Lever de lune, Causse Majean et Mer calme. Pour honorer des commandes de l’Etat, il devient décorateur avec Terre antique, le Temple (la salle de travail à l’Ecole des Hautes Etudes, à la Sorbonne (1905)), ; Terre antique, le golfe (bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, 1906), l'Age d'or, Rêve antique, la vie pastorale (pour la salle des actes, Faculté de droit de Paris, 1907-1909[4]), Le labour (Caisse d'épargne de Marseille, 1910), Crépuscule (Faculté de droit de Paris, 1914), Décoration de l'amphithéâtre de l'Institut de Physique-Chimie (Paris, 1926).
Ses pastels lui valent d’être présent à diverses expositions :
« (…) le métier de M. Ménard est un métier patient et tendre (…). Si son symbolisme un peu facile et suranné n’intéresse guère en lui-même, du moins il sait rendre la force expressive ou, mieux que tout autre, la lassitude de vivre que résigné, il signifie lentement. Quoi qu’il en soit M. Ménard a le métier le plus intéressant, le plus complet parmi tous les pastellistes présents. »[5]
Le critique Henri Frantz le sépare de Cottet et de Simon (classés dans le chapitre « Peintres de la Bretagne et de la mer »), pour l'intégrer dans son chapitre intitulé les « Peintres de rêves » :
« M. René Ménard ajoute chaque année à son œuvre quelques pages décisives. Mais rarement cet artiste nous a donné une plus profonde impression que dans ses six toiles de ce salon. Certaines d'entre elles font rêver, comme la plus subtile et la plus complexe des musiques, vous enveloppent d'une foule de sensations, de souvenirs, de visions… art d'un évocateur puissant, d'un véritable créateur de beauté. Sa conception de la Beauté, M. René Ménard la trouve aujourd'hui au-delà même de la Renaissance, et sur la terre classique. Le corps de femme, d'un modèle si ferme, qui surgit de la mer, c'est bien l'Astarté grecque dans toute sa splendeur. Ailleurs ce sont deux prêtresses en robes de lin, qui, sur le haut du promontoire où poussent les pins harmonieux jouent de la lyre, sans doute en chantant des vers de Pindare, puis encore sous des nuages flamboyants, dans leur solitude hautaine, les temples d'Agrigente, (…). »[6]
Il fut membre de la Société Nationale des Beaux-Arts. Il obtint une médaille de troisième classe en 1889, fut fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1900 et officier en 1910. Membre de l’Institut. Il est élu membre titulaire de l’Académie des Beaux-Arts (section peinture) en le 20 février 1926, au fauteuil de Léon Lhermitte.
« Cet érudit, héritier de Poussin et de Claude Lorrain, paraît avoir compté parmi les plus grandes figures de son temps. Tout en restant dans la grande tradition de l’Ecole Française, il semble s’être attaché à concilier l’idéalisme d’un Puvis de Chavannes à certaines conceptions impressionnistes de la lumière. »[7]
[2] René Ménard : 1862-1930. Château musée de Dieppe, juillet-septembre 1969, Préface de Pierre BAZIN.- Dieppe : Association des amis du vieux Dieppe, 1969. p. 10.
[3] R. BOUYER, « René Ménard », Art et décoration, juin 1914, p. 178.
[4] Actuellement au musée d'Orsay.
[5] A. FONTAINAS, « Revue du mois. Art moderne », Mercure de France (1889-1965), n°101, mai 1898,
p. 601.
[6] H. FRANTZ.- Notes sur les salons de 1899.- Paris : Bibliothèque de la Critique, 1899. p. 44.
[7] Vente L. René Ménard, 1862-1930 et ses amis (Cacan, Cazin, Cottet, Dauchez, Desvallières, Prinet, Simon). Paris : Claude Robert Commissaire Priseur, 12 décembre 1973. p. 5.
- Participations : de 1900 à 1914
- présent en : 1918, 1919, 1920, 1921, 1922.
René Marie Auguste Ménard est le fils du peintre René-Joseph Ménard (1827-1897) et neveu de Louis-Nicholas Ménard (1822-1901), directeur de la Gazette des beaux-arts, critique d'art, professeur et secrétaire de l'Ecole des Arts Décoratifs, dont il fit d'ailleurs un portrait très expressif présenté au Salon de 1894. Il reçoit donc une éducation artistique et intellectuelle classique. Il fut l'élève de Baudry et de Bouguereau, puis de Lehmann et à l'Académie Julian. Il débute au Salon des Artistes français en 1883 et se fit remarquer par des paysages. Il participe par la suite au SNBA, mais il aime davantage les expositions plus restreintes du genre de celle de la Société Nouvelle ou des Pastellistes.
Dès ses débuts, il manifeste un goût très vif pour l’Antiquité qui se traduit par un idéalisme symboliste un peu démodé dans des lumières chaudes, dont les figures sont d’un académisme sobre et grave. « Il passa sa jeunesse à Barbizon où il rencontra Millet et où il vit peindre Corot. »[2] Il semble vouloir redécouvrir la nature et entrer en communion avec elle. Il fait apparaître dans son œuvre un retour aux canons classiques, en affirmant un goût prononcé pour le crépuscule et l’obscurité, tout en adoptant la lumière de l’Impressionnisme.
« Oui, c’est un vrai classique, parce qu’il sait retrouver l’antique beauté dans l’éternelle nature et que le paysage historique n’est à ses yeux qu’un moyen de rendre visible la sereine majesté de ce beau panthéisme ».[3]
Il est souvent considéré comme un successeur de Poussin lorsqu’il réduit le personnage humain dans le champ de la toile au profit d’une nature envahissante. Ses nuages font l’admiration des critiques.
Assez vite, il affirme ses qualités de décorateur - qui elles, le classent parmi les suiveurs de Puvis de Chavannes - en produisant des œuvres plus importantes, empreintes de charme poétique, comme son exposition au Salon de 1899, où il présente six toiles Harmonie du Soir, Terre antique, Vue sur la mer, Lever de lune, Causse Majean et Mer calme. Pour honorer des commandes de l’Etat, il devient décorateur avec Terre antique, le Temple (la salle de travail à l’Ecole des Hautes Etudes, à la Sorbonne (1905)), ; Terre antique, le golfe (bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, 1906), l'Age d'or, Rêve antique, la vie pastorale (pour la salle des actes, Faculté de droit de Paris, 1907-1909[4]), Le labour (Caisse d'épargne de Marseille, 1910), Crépuscule (Faculté de droit de Paris, 1914), Décoration de l'amphithéâtre de l'Institut de Physique-Chimie (Paris, 1926).
Ses pastels lui valent d’être présent à diverses expositions :
« (…) le métier de M. Ménard est un métier patient et tendre (…). Si son symbolisme un peu facile et suranné n’intéresse guère en lui-même, du moins il sait rendre la force expressive ou, mieux que tout autre, la lassitude de vivre que résigné, il signifie lentement. Quoi qu’il en soit M. Ménard a le métier le plus intéressant, le plus complet parmi tous les pastellistes présents. »[5]
Le critique Henri Frantz le sépare de Cottet et de Simon (classés dans le chapitre « Peintres de la Bretagne et de la mer »), pour l'intégrer dans son chapitre intitulé les « Peintres de rêves » :
« M. René Ménard ajoute chaque année à son œuvre quelques pages décisives. Mais rarement cet artiste nous a donné une plus profonde impression que dans ses six toiles de ce salon. Certaines d'entre elles font rêver, comme la plus subtile et la plus complexe des musiques, vous enveloppent d'une foule de sensations, de souvenirs, de visions… art d'un évocateur puissant, d'un véritable créateur de beauté. Sa conception de la Beauté, M. René Ménard la trouve aujourd'hui au-delà même de la Renaissance, et sur la terre classique. Le corps de femme, d'un modèle si ferme, qui surgit de la mer, c'est bien l'Astarté grecque dans toute sa splendeur. Ailleurs ce sont deux prêtresses en robes de lin, qui, sur le haut du promontoire où poussent les pins harmonieux jouent de la lyre, sans doute en chantant des vers de Pindare, puis encore sous des nuages flamboyants, dans leur solitude hautaine, les temples d'Agrigente, (…). »[6]
Il fut membre de la Société Nationale des Beaux-Arts. Il obtint une médaille de troisième classe en 1889, fut fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1900 et officier en 1910. Membre de l’Institut. Il est élu membre titulaire de l’Académie des Beaux-Arts (section peinture) en le 20 février 1926, au fauteuil de Léon Lhermitte.
« Cet érudit, héritier de Poussin et de Claude Lorrain, paraît avoir compté parmi les plus grandes figures de son temps. Tout en restant dans la grande tradition de l’Ecole Française, il semble s’être attaché à concilier l’idéalisme d’un Puvis de Chavannes à certaines conceptions impressionnistes de la lumière. »[7]
[2] René Ménard : 1862-1930. Château musée de Dieppe, juillet-septembre 1969, Préface de Pierre BAZIN.- Dieppe : Association des amis du vieux Dieppe, 1969. p. 10.
[3] R. BOUYER, « René Ménard », Art et décoration, juin 1914, p. 178.
[4] Actuellement au musée d'Orsay.
[5] A. FONTAINAS, « Revue du mois. Art moderne », Mercure de France (1889-1965), n°101, mai 1898,
p. 601.
[6] H. FRANTZ.- Notes sur les salons de 1899.- Paris : Bibliothèque de la Critique, 1899. p. 44.
[7] Vente L. René Ménard, 1862-1930 et ses amis (Cacan, Cazin, Cottet, Dauchez, Desvallières, Prinet, Simon). Paris : Claude Robert Commissaire Priseur, 12 décembre 1973. p. 5.