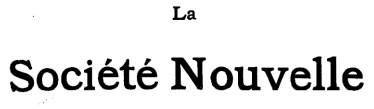LUCIEN SIMON

SIMON, Lucien (Paris, 8 juillet 1861 ; Sainte-Marine en Combrit, 13 octobre 1945) :
Il est né dans une famille bourgeoise parisienne, aisée et instruite. Il termine ses études classiques avant d’entamer progressivement une carrière picturale. Son père meurt lorsqu’il a 17 ans, mais grâce à l’aide de sa mère, il n’a pas de soucis matériels. Il prend des cours auprès de Jules Didier (1831-1892), ancien Grand Prix de Rome, en 1878, il y reste un an et y fait la connaissance de René-Xavier Prinet, futur membre, comme lui, de la « Bande Noire » et de la « Société Nouvelle ». Il part faire son service militaire en 1880 qu’il effectue en compagnie du peintre Georges Desvallières. Il s’installe dès 1880, dans un atelier 16 impasse du Maine, futur Musée Bourdelle. Simon aura comme voisin, Antoine Bourdelle (arrivé en 1885), Eugène Carrière ou Prinet (arrivé en 1886). Dans cet atelier il rencontre Manet peu de temps avant sa mort, et voit, avant son exposition au Salon, Bar aux Folies Bergères. Il gardera dès lors un fort penchant pour l’esthétique du peintre[1]. En 1883, il retrouve Desvallières à l’Académie Julian ; il est l'élève de Tony Robert-Fleury et de William Bouguereau. Dans cette Académie, il se lie aussi d’amitié avec Ménard et le futur orientaliste Etienne Dinet, avec qui il part en Algérie en 1884. C’est auprès de toutes ces rencontres, où l’émulation est réciproque, que Lucien Simon va forger son style.
Il débute en 1881, au Salon des Artistes français[2] avec deux aquarelles. Il y expose régulièrement, souvent des portraits, souvent, familiaux, veine qu’il exploitera largement et avec brio toute sa vie[3]. Le portrait de sa mère lui permet d’obtenir sa première médaille Mention honorable en 1885. Il peint alors des toiles académiques qui reflètent son intérêt pour les scènes de genre (Jeunes filles ornant un autel, 1887), puis pour celles d’intérieurs (La lecture entre amis, 1888). Il montre application et gravité dans des toiles d’ambiance (L’atelier, 1922). Son dessin est très vigoureux, sa palette chaude et colorée. Il ne rejoint le Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts qu’à partir de 1893, date à laquelle l’Etat lui achète pour la première fois une œuvre, Fin de séance (Château de Vitré).
A partir de 1892, à la suite de son mariage avec Jeanne Dauchez, sœur du peintre, il découvre la Bretagne à Bénodet. Kergaït, maison familiale des Dauchez, va accueillir le peintre et son épouse jusqu’en 1902. Cette année-là, les Simon acquièrent le Sémaphore à Sainte-Marine. Il y peint la vie quotidienne, les parents et amis de passage conversant ou dînant avec pour décor de fond les rives de l’Odet.
« La découverte de la Bretagne lui ouvre une voie neuve ; il peint avec vivacité, dans une matière grasse mais solide, des sujets quotidiens (L’Enterrement breton, 1895 (Musée des Beaux-Arts de Lille), La Procession à Penmarch, 1901 (Musée d’Orsay)). Il voyage en Hollande et en Espagne, où il découvre les œuvres de Goya et de Velázquez, expose au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts ; fidèle à la Bretagne, il enrichit son art de couleurs chatoyantes et adopte un style d’esquisse qui donne à ses sujets (Jeunes Bigoudènes aux courses) spontanéité et fraîcheur. »[4]
Etiqueté peintre de la « Bande noire », pour ses toiles sombres et son exploitation constante du thème de la Bretagne, il devient surtout « le peintre du Pays Bigouden », mais son regard est plus gai que celui de Cottet.
« Témoin privilégié de la vie quotidienne, il peint les sorties de messe, les cortèges de noces, les processions, les parades foraines, les marchés, les pardons, les scènes de port ou de brûlage de goémon. Grâce à sa maîtrise de peintre il échappe toutefois à la simple anecdote et il rompt avec l’imagerie conventionnelle du XIXe. Lucien Simon, tout comme un Charles Cottet, a tenté de lier tradition et novation. Tout en assimilant les leçons de l’impressionnisme, il a voulu retrouver les leçons de maîtres anciens, en particulier celles de Frans Hals. Sa peinture associe une composition savante, solidement charpentée, bâtie à partir du groupe principal et d’effets valorisés, à une facture large, mettant en œuvre des couleurs claires. »[5]
En 1900 il obtient tout comme Aman-Jean, Cottet, Blanche et Prinet, la médaille d’or à la décennale de l’Exposition universelle de Paris et est également nommé chevalier de la Légion d’honneur. Comme Cottet, rencontré dans les années 1890 au Salon de la Nationale, il garde en mémoire les contrastes du noir et du blanc, la tension intérieure et la spontanéité des poses prises sur le vif des personnages du grand portraitiste Hals (Les régentes de l’hospice des vieillards, 1664 (Haarlem)). Outre ses œuvres d’inspiration bretonne, il se consacre à deux thèmes qu’il affectionne, les portraits, notamment ses enfants, et les scènes intimistes. Cette œuvre de portraitiste fera de lui un membre honoraire de la « National Portrait Society » de Londres en 1910. A cette date, Valmy-Baisse, lui consacre un ouvrage dans la collection « Peintres d’aujourd’hui » (collection qui honorera également son ami Cottet).
Très célèbre en son temps, il participe aux Sécessions de Berlin, de Munich et de Vienne, à l’International Society de Londres, expose à Paris chez Bernheim Jeune (1912). En 1907, il signe un contrat d’exclusivité sur la vente de ses toiles à la galerie Bernheim-Jeune, cela le détache un peu de son appartenance à la « Bande noire » et à la « Société Nouvelle ». Sa rétrospective à la Galerie Charpentier en 1932 obtient un grand succès. Il est élu à l’Institut de France en 1927[6]. De nombreux Musées possèdent ses œuvres, notamment le Musée National d’Art Moderne, les Musées d’Orsay, de Rouen, de Lyon, de Nantes, de Stockholm, de Moscou, d’Helsinki, de Chicago, de Venise…. Il reçoit le grand prix à l'Exposition universelle de Paris en 1937.
« Le succès de ces ouvrages fut si général qu’à l’étranger tous les Musées et tous les amateurs acquirent des toiles de Lucien Simon, comme exemple de la forte technique parisienne. »[7]
Il enseigne à l’Académie de la palette en 1906 et à partir de 1923 à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, où son atelier est très couru. Professeur faisant partager sa passion, il emmène ses élèves peindre sur le motif, en contact direct avec la nature. Il règne dans ses cours un vent de libéralisme et de générosité. C’est aussi dans cet esprit qu’il crée en 1923 le Salon des Tuileries, en demandant aux participants de la Nationale, du Salon d’Automne et des Indépendants de se joindre à lui. En 1934, il réalise 50 illustrations pour Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Il a influencé des artistes comme Yves Brayer et Georges Rohner dont il a été le professeur. Le peintre breton, Mathurin Méheut peint avec la même vivacité, la même rapidité d’exécution, ose les mêmes couleurs chatoyantes et a lui aussi illustré Pêcheurs d’Islande.
Chronologie biographique :
1901, voyage à Londres avec Prinet ; enseigne à l'Académie de la Palette.
1904, fondation des ateliers de la Grande Chaumière.
1906, construction de sa maison rue Cassini, voisin de Cottet. Voyage à Rome avec les Ménard et sa femme.
1908, voyage en Algérie avec son fils Paul, sa femme, Ménard et Prinet.
1913, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh, pour la
1917, mission officielle pour des « Croquis de guerre ».
1922-1936, Professeur de peinture à l'Ecole nationale des Beaux-Arts (Président en 1931[9]).
1923, quitte la Nationale pour lancer le Salon des Tuileries avec Aman-Jean, Besnard, Bourdelle, Denis, Desvallières, Prinet et Ménard.
1926, voyage en Espagne.
1927, élu à l’Académie des Beaux-Arts.
1928, voyage au Maroc.
1931, conférences sur l’histoire de l’art à Buenos Aires.
1934, Peintre de la Marine
1937-1943, Directeur du Musée Jacquemart-André ; Membre de la Société royale des Beaux-Arts de Bruxelles, de la National Portrait Society (Londres) et du Salon international du Carnegie Institute de Pittsburgh ; Membre du conseil des Musées nationaux.
Expositions :
1907, signature d’un contrat d’exclusivité avec la galerie Bernheim-Jeune.
1912, exposition personnelle à la Biennale de Venise, à la galerie Bernheim-Jeune.
1914, exposition personnelle au Carnegie Institute de Pittsburgh.
1913, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh, pour la treizième édition du salon où il présente son grand tableau de 1904 Soirée dans l’atelier (la Nationale 1905), où l’on retrouve représentés Cottet, Desvallières, Prinet et Saglio.
1920, exposition à la Société internationale de la Peinture à l’eau en janvier 1920 où il présente Nausicaa ;
1925, exposition personnelle au Salon Witcom à Buenos Aires.
1934, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh ; illustre Pêcheur d’Islande de Loti.
Commandes :
1913, Brûlage de goémon à la chapelle Notre-Dame-de-la-joie pour le Musée des Beaux-Arts de Quimper.
1920, La Messe du soldat mort et le Sacrifice pour le baptistère de l’Eglise Notre-Dame-Du-Travail à Paris ; exposition à la Société internationale de la Peinture à l’eau en janvier 1920 où il présente Nausicaa ; illustrations du livre d’Edouard Haraucourt « Le Poison » et avec Dauchez et Cottet, du « Livre de l’émeraude » d’André Suarès.
1922, Commande de la décoration de l’escalier du Sénat (inauguration en 1929), 1928, décoration de l’escalier d'honneur du Sénat (en collaboration avec M. Denis).
1933, décoration du cercle des officiers de marine à Toulon, illustrant les romans de Pierre Loti.
1934, décoration de l’église de la Roberstau à Strasbourg
1937, décoration pour le pavillon du Grand-Duché du Luxembourg à l’exposition universelle ; obtient le grand prix.
1914, illustration du Livre d’émeraude d’André Suarès[10].
[1] En 1889, il peint Le Banc, représentant sa mère et son demi-frère dans une attitude et un traitement très proches du travail de Manet. (Cf. toile dans cat expo galerie Heim).
[2] Il ne rejoint ses amis à la « Nationale » que trois ans après sa création en 1890.
[3] Un voyage en 1882, en Hollande pour découvrir les maîtres anciens et Frans Hals en particulier, va orienter et affirmer son goût pour le portrait.
[4] G. SCHURR et P. CABANNE.- Dictionnaire des petits maîtres…op. cit., vol. 2, p. 416.
[5] Bilan des acquisitions du FRAM Bretagne 1982-1990.- Rennes : Association des conservateurs des Musées de Bretagne, 1990. p. 164.
[6] Elu le 5 mars 1927, membre titulaire de l'Académie des BA (section peinture), au fauteuil d'Adolphe Dechenaud et devient président en 1931.
[7] J-E. BLANCHE.- Les arts plastiques.- Paris : Impr. Nouvelle, 1931. p. 188-189.
[9] Walter Gay le félicite dans un courrier en janvier 1931. Cf Annexes Iconographiques (Ill. 143b)
[10] André SUARES.- Le livre de l'émeraude, en Bretagne. Compositions de MM. C. Cottet, A. Dauchez, L. Simon, gravées à l'eau-forte par MM. Cottet et Dauchez.- Paris: Société du livre d'art, 1914. 213 p.
- Participations : 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914.
- Présent en 1918, 1919 et 1920.
Il est né dans une famille bourgeoise parisienne, aisée et instruite. Il termine ses études classiques avant d’entamer progressivement une carrière picturale. Son père meurt lorsqu’il a 17 ans, mais grâce à l’aide de sa mère, il n’a pas de soucis matériels. Il prend des cours auprès de Jules Didier (1831-1892), ancien Grand Prix de Rome, en 1878, il y reste un an et y fait la connaissance de René-Xavier Prinet, futur membre, comme lui, de la « Bande Noire » et de la « Société Nouvelle ». Il part faire son service militaire en 1880 qu’il effectue en compagnie du peintre Georges Desvallières. Il s’installe dès 1880, dans un atelier 16 impasse du Maine, futur Musée Bourdelle. Simon aura comme voisin, Antoine Bourdelle (arrivé en 1885), Eugène Carrière ou Prinet (arrivé en 1886). Dans cet atelier il rencontre Manet peu de temps avant sa mort, et voit, avant son exposition au Salon, Bar aux Folies Bergères. Il gardera dès lors un fort penchant pour l’esthétique du peintre[1]. En 1883, il retrouve Desvallières à l’Académie Julian ; il est l'élève de Tony Robert-Fleury et de William Bouguereau. Dans cette Académie, il se lie aussi d’amitié avec Ménard et le futur orientaliste Etienne Dinet, avec qui il part en Algérie en 1884. C’est auprès de toutes ces rencontres, où l’émulation est réciproque, que Lucien Simon va forger son style.
Il débute en 1881, au Salon des Artistes français[2] avec deux aquarelles. Il y expose régulièrement, souvent des portraits, souvent, familiaux, veine qu’il exploitera largement et avec brio toute sa vie[3]. Le portrait de sa mère lui permet d’obtenir sa première médaille Mention honorable en 1885. Il peint alors des toiles académiques qui reflètent son intérêt pour les scènes de genre (Jeunes filles ornant un autel, 1887), puis pour celles d’intérieurs (La lecture entre amis, 1888). Il montre application et gravité dans des toiles d’ambiance (L’atelier, 1922). Son dessin est très vigoureux, sa palette chaude et colorée. Il ne rejoint le Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts qu’à partir de 1893, date à laquelle l’Etat lui achète pour la première fois une œuvre, Fin de séance (Château de Vitré).
A partir de 1892, à la suite de son mariage avec Jeanne Dauchez, sœur du peintre, il découvre la Bretagne à Bénodet. Kergaït, maison familiale des Dauchez, va accueillir le peintre et son épouse jusqu’en 1902. Cette année-là, les Simon acquièrent le Sémaphore à Sainte-Marine. Il y peint la vie quotidienne, les parents et amis de passage conversant ou dînant avec pour décor de fond les rives de l’Odet.
« La découverte de la Bretagne lui ouvre une voie neuve ; il peint avec vivacité, dans une matière grasse mais solide, des sujets quotidiens (L’Enterrement breton, 1895 (Musée des Beaux-Arts de Lille), La Procession à Penmarch, 1901 (Musée d’Orsay)). Il voyage en Hollande et en Espagne, où il découvre les œuvres de Goya et de Velázquez, expose au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts ; fidèle à la Bretagne, il enrichit son art de couleurs chatoyantes et adopte un style d’esquisse qui donne à ses sujets (Jeunes Bigoudènes aux courses) spontanéité et fraîcheur. »[4]
Etiqueté peintre de la « Bande noire », pour ses toiles sombres et son exploitation constante du thème de la Bretagne, il devient surtout « le peintre du Pays Bigouden », mais son regard est plus gai que celui de Cottet.
« Témoin privilégié de la vie quotidienne, il peint les sorties de messe, les cortèges de noces, les processions, les parades foraines, les marchés, les pardons, les scènes de port ou de brûlage de goémon. Grâce à sa maîtrise de peintre il échappe toutefois à la simple anecdote et il rompt avec l’imagerie conventionnelle du XIXe. Lucien Simon, tout comme un Charles Cottet, a tenté de lier tradition et novation. Tout en assimilant les leçons de l’impressionnisme, il a voulu retrouver les leçons de maîtres anciens, en particulier celles de Frans Hals. Sa peinture associe une composition savante, solidement charpentée, bâtie à partir du groupe principal et d’effets valorisés, à une facture large, mettant en œuvre des couleurs claires. »[5]
En 1900 il obtient tout comme Aman-Jean, Cottet, Blanche et Prinet, la médaille d’or à la décennale de l’Exposition universelle de Paris et est également nommé chevalier de la Légion d’honneur. Comme Cottet, rencontré dans les années 1890 au Salon de la Nationale, il garde en mémoire les contrastes du noir et du blanc, la tension intérieure et la spontanéité des poses prises sur le vif des personnages du grand portraitiste Hals (Les régentes de l’hospice des vieillards, 1664 (Haarlem)). Outre ses œuvres d’inspiration bretonne, il se consacre à deux thèmes qu’il affectionne, les portraits, notamment ses enfants, et les scènes intimistes. Cette œuvre de portraitiste fera de lui un membre honoraire de la « National Portrait Society » de Londres en 1910. A cette date, Valmy-Baisse, lui consacre un ouvrage dans la collection « Peintres d’aujourd’hui » (collection qui honorera également son ami Cottet).
Très célèbre en son temps, il participe aux Sécessions de Berlin, de Munich et de Vienne, à l’International Society de Londres, expose à Paris chez Bernheim Jeune (1912). En 1907, il signe un contrat d’exclusivité sur la vente de ses toiles à la galerie Bernheim-Jeune, cela le détache un peu de son appartenance à la « Bande noire » et à la « Société Nouvelle ». Sa rétrospective à la Galerie Charpentier en 1932 obtient un grand succès. Il est élu à l’Institut de France en 1927[6]. De nombreux Musées possèdent ses œuvres, notamment le Musée National d’Art Moderne, les Musées d’Orsay, de Rouen, de Lyon, de Nantes, de Stockholm, de Moscou, d’Helsinki, de Chicago, de Venise…. Il reçoit le grand prix à l'Exposition universelle de Paris en 1937.
« Le succès de ces ouvrages fut si général qu’à l’étranger tous les Musées et tous les amateurs acquirent des toiles de Lucien Simon, comme exemple de la forte technique parisienne. »[7]
Il enseigne à l’Académie de la palette en 1906 et à partir de 1923 à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, où son atelier est très couru. Professeur faisant partager sa passion, il emmène ses élèves peindre sur le motif, en contact direct avec la nature. Il règne dans ses cours un vent de libéralisme et de générosité. C’est aussi dans cet esprit qu’il crée en 1923 le Salon des Tuileries, en demandant aux participants de la Nationale, du Salon d’Automne et des Indépendants de se joindre à lui. En 1934, il réalise 50 illustrations pour Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Il a influencé des artistes comme Yves Brayer et Georges Rohner dont il a été le professeur. Le peintre breton, Mathurin Méheut peint avec la même vivacité, la même rapidité d’exécution, ose les mêmes couleurs chatoyantes et a lui aussi illustré Pêcheurs d’Islande.
Chronologie biographique :
1901, voyage à Londres avec Prinet ; enseigne à l'Académie de la Palette.
1904, fondation des ateliers de la Grande Chaumière.
1906, construction de sa maison rue Cassini, voisin de Cottet. Voyage à Rome avec les Ménard et sa femme.
1908, voyage en Algérie avec son fils Paul, sa femme, Ménard et Prinet.
1913, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh, pour la
1917, mission officielle pour des « Croquis de guerre ».
1922-1936, Professeur de peinture à l'Ecole nationale des Beaux-Arts (Président en 1931[9]).
1923, quitte la Nationale pour lancer le Salon des Tuileries avec Aman-Jean, Besnard, Bourdelle, Denis, Desvallières, Prinet et Ménard.
1926, voyage en Espagne.
1927, élu à l’Académie des Beaux-Arts.
1928, voyage au Maroc.
1931, conférences sur l’histoire de l’art à Buenos Aires.
1934, Peintre de la Marine
1937-1943, Directeur du Musée Jacquemart-André ; Membre de la Société royale des Beaux-Arts de Bruxelles, de la National Portrait Society (Londres) et du Salon international du Carnegie Institute de Pittsburgh ; Membre du conseil des Musées nationaux.
Expositions :
1907, signature d’un contrat d’exclusivité avec la galerie Bernheim-Jeune.
1912, exposition personnelle à la Biennale de Venise, à la galerie Bernheim-Jeune.
1914, exposition personnelle au Carnegie Institute de Pittsburgh.
1913, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh, pour la treizième édition du salon où il présente son grand tableau de 1904 Soirée dans l’atelier (la Nationale 1905), où l’on retrouve représentés Cottet, Desvallières, Prinet et Saglio.
1920, exposition à la Société internationale de la Peinture à l’eau en janvier 1920 où il présente Nausicaa ;
1925, exposition personnelle au Salon Witcom à Buenos Aires.
1934, exposition personnelle au Carnegie Institute à Pittsburgh ; illustre Pêcheur d’Islande de Loti.
Commandes :
1913, Brûlage de goémon à la chapelle Notre-Dame-de-la-joie pour le Musée des Beaux-Arts de Quimper.
1920, La Messe du soldat mort et le Sacrifice pour le baptistère de l’Eglise Notre-Dame-Du-Travail à Paris ; exposition à la Société internationale de la Peinture à l’eau en janvier 1920 où il présente Nausicaa ; illustrations du livre d’Edouard Haraucourt « Le Poison » et avec Dauchez et Cottet, du « Livre de l’émeraude » d’André Suarès.
1922, Commande de la décoration de l’escalier du Sénat (inauguration en 1929), 1928, décoration de l’escalier d'honneur du Sénat (en collaboration avec M. Denis).
1933, décoration du cercle des officiers de marine à Toulon, illustrant les romans de Pierre Loti.
1934, décoration de l’église de la Roberstau à Strasbourg
1937, décoration pour le pavillon du Grand-Duché du Luxembourg à l’exposition universelle ; obtient le grand prix.
1914, illustration du Livre d’émeraude d’André Suarès[10].
[1] En 1889, il peint Le Banc, représentant sa mère et son demi-frère dans une attitude et un traitement très proches du travail de Manet. (Cf. toile dans cat expo galerie Heim).
[2] Il ne rejoint ses amis à la « Nationale » que trois ans après sa création en 1890.
[3] Un voyage en 1882, en Hollande pour découvrir les maîtres anciens et Frans Hals en particulier, va orienter et affirmer son goût pour le portrait.
[4] G. SCHURR et P. CABANNE.- Dictionnaire des petits maîtres…op. cit., vol. 2, p. 416.
[5] Bilan des acquisitions du FRAM Bretagne 1982-1990.- Rennes : Association des conservateurs des Musées de Bretagne, 1990. p. 164.
[6] Elu le 5 mars 1927, membre titulaire de l'Académie des BA (section peinture), au fauteuil d'Adolphe Dechenaud et devient président en 1931.
[7] J-E. BLANCHE.- Les arts plastiques.- Paris : Impr. Nouvelle, 1931. p. 188-189.
[9] Walter Gay le félicite dans un courrier en janvier 1931. Cf Annexes Iconographiques (Ill. 143b)
[10] André SUARES.- Le livre de l'émeraude, en Bretagne. Compositions de MM. C. Cottet, A. Dauchez, L. Simon, gravées à l'eau-forte par MM. Cottet et Dauchez.- Paris: Société du livre d'art, 1914. 213 p.